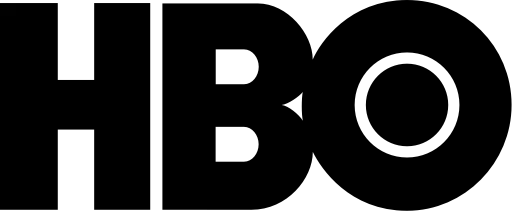Saviez-vous que la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise émet en moyenne 11,4 fois plus d’émissions que son activité directe ? La norme ISO 14067 répond précisément à ce défi en définissant les exigences essentielles pour mesurer et réduire l’empreinte carbone des produits .
Publiée en 2018, la norme internationale ISO 14067:2018 spécifie les lignes directrices relatives à la quantification et à la déclaration de l’empreinte carbone des produits (ECP) . Cette méthodologie rigoureuse est devenue indispensable dans un contexte où, selon le dernier rapport du GIEC, nous devons diminuer nos émissions de 27 à 43% d’ici 2030 pour respecter l’Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à +1,5°C . De plus, plus d’un Français sur deux évalue désormais systématiquement l’impact environnemental des produits qu’il achète .
Cette norme offre ainsi un cadre méthodologique complet pour quantifier les émissions de CO₂e associées aux biens et services . Elle prend en compte tous les flux entrants et sortants intervenant aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement , permettant aux entreprises d’identifier les points critiques de leur empreinte carbone et d’agir efficacement pour la réduire.
Comprendre la norme ISO 14067:2018 et son périmètre
La norme ISO 14067:2018 représente un cadre méthodologique essentiel pour les organisations cherchant à évaluer l’impact climatique de leurs produits. Publiée en 2018, cette norme internationale remplace la spécification technique ISO/TS 14067 de 2013 [1] et s’inscrit dans la série ISO 14060 consacrée à la mesure, au suivi et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Définition de l’empreinte carbone des produits (ECP)
L’empreinte carbone d’un produit (ECP), également connue sous le nom de Product Carbon Footprint (PCF), désigne la quantité totale d’émissions de GES exprimée en équivalents de CO₂, attribuée à un produit tout au long de son cycle de vie [2]. Cette approche mono-critère se concentre exclusivement sur l’indicateur de changement climatique [3], contrairement à une analyse environnementale plus globale.
La norme ISO 14067 offre une méthodologie scientifique rigoureuse qui prend en compte les émissions depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie du produit [3]. En effet, elle permet d’analyser les émissions à chaque étape :
- Extraction des matières premières : impact des ressources utilisées
- Fabrication : consommation d’énergie et émissions liées aux processus industriels
- Transport et distribution : émissions liées à la logistique
- Utilisation du produit : énergie consommée pendant sa durée de vie
- Fin de vie : recyclage, valorisation énergétique ou mise en décharge [3]
Par ailleurs, cette norme s’applique aussi bien aux produits physiques qu’aux services, ce qui la rend particulièrement polyvalente [4]. Elle contribue ainsi directement à l’Objectif de développement durable n° 13 (action climatique) de l’Agenda 2030 des Nations Unies [1].
Différences entre ISO 14067 et ISO 14064
Alors que l’ISO 14067 se concentre sur l’empreinte carbone des produits, l’ISO 14064 aborde la gestion des émissions de GES au niveau organisationnel [4]. Cette distinction fondamentale oriente leur application selon les objectifs poursuivis par l’entreprise.
En effet, l’ISO 14067 adopte une perspective ciblée sur un produit spécifique, permettant d’analyser son impact carbone tout au long de son cycle de vie [5]. Elle utilise généralement une approche « du berceau à la tombe » (cradle-to-grave) qui couvre l’ensemble du cycle de vie, bien que des approches partielles comme « du berceau à la porte » (cradle-to-gate) ou « de porte à porte » (gate-to-gate) soient également possibles [6].
À l’inverse, l’ISO 14064 offre une vision plus large des émissions d’une organisation. Une entreprise souhaitant divulguer ses émissions globales au niveau organisationnel optera pour l’ISO 14064, tandis qu’elle choisira l’ISO 14067 pour identifier précisément les processus générant le plus d’émissions pour un produit spécifique [6].
Lien avec les normes ISO 14040 et ISO 14044
La norme ISO 14067 s’appuie fondamentalement sur les principes de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) définis dans les normes ISO 14040 et ISO 14044 [7]. Ces dernières établissent le cadre méthodologique général pour réaliser une ACV complète, tandis que l’ISO 14067 adapte ces principes spécifiquement à l’évaluation de l’empreinte carbone.
En d’autres termes, l’ISO 14067 reprend la structure méthodologique des normes d’ACV mais concentre son analyse uniquement sur l’impact climatique [8]. Elle intègre également des exigences spécifiques pertinentes pour l’empreinte carbone, notamment concernant les changements d’affectation des terres, la captation de carbone, les émissions de carbone biogénique et les modifications du carbone dans le sol [8].
Cette complémentarité avec les normes ISO 14040/44 permet aux organisations de réaliser des évaluations précises de l’empreinte carbone tout en maintenant la rigueur méthodologique requise pour des analyses environnementales complètes [8]. La norme ISO 14067 représente ainsi un outil stratégique pour identifier les points critiques d’émission et mettre en œuvre des mesures ciblées de réduction de l’impact carbone des produits.
Méthodologie de calcul selon la norme ISO 14067
La méthodologie définie par la norme ISO 14067 repose sur une approche scientifique rigoureuse pour quantifier l’empreinte carbone d’un produit. Cette méthode standardisée permet d’obtenir des résultats fiables et comparables entre différentes organisations.
Analyse du cycle de vie (ACV) centrée sur le changement climatique
L’ISO 14067 s’appuie fondamentalement sur les principes de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) établis dans les normes ISO 14040 et ISO 14044, mais se concentre exclusivement sur la catégorie d’impact du changement climatique [9]. Cette approche mono-critère, également appelée Product Carbon Footprint (PCF), évalue les émissions de gaz à effet de serre générées à chaque étape du cycle de vie d’un produit [10].
La méthodologie se décompose en quatre phases principales :
- Définition des objectifs et du champ d’étude
- Analyse de l’inventaire du cycle de vie
- Évaluation de l’impact climatique
- Interprétation des résultats [11]
Contrairement à une ACV complète qui couvre plusieurs impacts environnementaux, l’ISO 14067 se limite à l’empreinte carbone, ce qui facilite les calculs tout en offrant des informations précieuses sur l’impact climatique d’un produit [12].
Collecte des données : flux entrants et sortants
La phase d’inventaire exige une collecte minutieuse de toutes les données pertinentes sur les flux entrants et sortants du système étudié. Ces données comprennent :
- Données primaires : informations directes provenant des opérations de l’entreprise (consommation d’énergie, matières premières, émissions de fabrication, distances de transport)
- Données secondaires : issues de bases de données industrielles (comme ecoinvent, GaBi) ou de valeurs moyennes basées sur la littérature scientifique [13]
Pour chaque étape du cycle de vie, il est nécessaire d’identifier et de quantifier toutes les consommations de ressources et les émissions générées [14]. Par ailleurs, la qualité des données collectées doit respecter plusieurs critères : couverture complète du cycle de vie, forte représentativité (lieu, période, technologie) et sources traçables et vérifiables [13].
Utilisation des facteurs d’émission (IPCC, ADEME)
Une fois les données collectées, l’étape suivante consiste à les convertir en émissions de GES à l’aide de facteurs d’émission reconnus internationalement. Ces facteurs proviennent notamment :
- Du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC/IPCC)
- De l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
- D’autres bases de données spécialisées comme ProBas [7] [11]
Le choix des facteurs d’émission influence considérablement les résultats finaux. Par exemple, les émissions liées au laiton peuvent être 72% plus faibles en utilisant la base ProBas plutôt que celle du GIEC [11]. Pour cette raison, l’ISO 14067 recommande de privilégier les facteurs provenant des fournisseurs directs, puis des bases de données officielles [3].
Conversion en équivalent CO₂
L’ISO 14067 exige que toutes les émissions de gaz à effet de serre soient exprimées en équivalent CO₂ (CO₂e), ce qui permet de comparer l’impact des différents GES sur le réchauffement climatique [15]. Cette conversion s’effectue en utilisant les Potentiels de Réchauffement Global (PRG) établis par le GIEC.
Les principaux GES à prendre en compte selon la norme sont : le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄), le protoxyde d’azote (N₂O), l’hexafluorure de soufre (SF₆), les perfluorocarbures (PFC) et les hydrofluorocarbures (HFC) [3]. Chaque gaz possède un PRG spécifique qui reflète sa capacité à retenir la chaleur dans l’atmosphère par rapport au CO₂. Par exemple :
- 1 kg de CH₄ = 27,9 kg CO₂e
- 1 kg de N₂O = 273 kg CO₂e [16]
Prise en compte des incertitudes
L’analyse des incertitudes constitue un aspect fondamental de la méthodologie ISO 14067. En effet, l’incertitude peut affecter significativement la qualité et l’application des résultats d’une ACV [17]. La norme définit l’incertitude comme un « paramètre associé au résultat de quantification qui caractérise la dispersion des valeurs pouvant être raisonnablement attribuées à la quantité mesurée » [15].
Plusieurs types d’incertitudes doivent être considérés :
- Incertitude des paramètres (facteurs d’émission, données d’activité)
- Incertitude des scénarios (phase d’utilisation, fin de vie)
- Incertitude des modèles [15] [17]
Pour limiter ces incertitudes, la norme recommande d’effectuer des analyses de sensibilité, d’utiliser des méthodes statistiques comme les simulations de Monte-Carlo et de documenter précisément toutes les hypothèses et choix méthodologiques [18]. Cette démarche rigoureuse permet d’accroître la fiabilité des résultats et de faciliter leur interprétation.
Étapes pratiques pour mettre en œuvre ISO 14067
La mise en œuvre concrète de la norme ISO 14067 nécessite une démarche structurée pour garantir des résultats fiables et comparables. Voici les étapes essentielles pour réaliser une empreinte carbone produit conforme à cette norme internationale.
Définir les frontières du système
Avant toute collecte de données, il est fondamental de préciser clairement le périmètre de l’étude. Cette étape initiale consiste à déterminer les produits à évaluer et les phases du cycle de vie couvertes [1]. Deux approches principales existent :
- L’approche « du berceau à la porte » (cradle-to-gate) : depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie d’usine
- L’approche « du berceau à la tombe » (cradle-to-grave) : couvrant l’intégralité du cycle de vie [19]
L’établissement de frontières précises évite la collecte de données superflues et permet de concentrer les efforts sur les informations pertinentes, accélérant ainsi l’ensemble du processus de mesure [1].
Réaliser l’inventaire des émissions de GES
Cette phase exige de rassembler des données détaillées sur chaque étape du cycle de vie du produit. Par conséquent, deux types de données sont nécessaires :
- Données primaires : obtenues directement des opérations de l’organisation
- Données secondaires : issues de bases de données reconnues comme Ecoinvent ou GaBi [20]
La norme ISO 14067 privilégie les données primaires pour renforcer la précision des calculs [21]. Néanmoins, lorsqu’elles sont indisponibles, l’utilisation de données secondaires est acceptable à condition de justifier soigneusement leur sélection [19].
Calculer l’empreinte carbone avec un logiciel dédié
Le calcul manuel s’avère chronophage et source potentielle d’erreurs [1]. Ainsi, des outils numériques comme SimaPro, OpenLCA ou CarbonScope automatisent les calculs selon les normes ISO 14067 [22]. Ces logiciels simplifient la gestion des données, assurent l’exactitude des résultats et améliorent l’efficacité globale du processus [21].
En outre, ces plateformes permettent d’identifier les « points chauds » d’émission et facilitent la traçabilité complète des données pour répondre aux exigences réglementaires [6].
Faire vérifier les résultats par un tiers indépendant
La vérification externe constitue une étape cruciale pour la crédibilité des résultats. Un auditeur indépendant examine minutieusement la méthodologie, les frontières définies et les calculs réalisés [5].
Cette vérification garantit que les résultats sont cohérents, précis et, si communiqués à l’externe, transparents [5]. Des organismes comme LRQA, SGS ou AFNOR peuvent délivrer une certification officielle attestant de la démarche [22]. Par ailleurs, l’accréditation ajoute une couche supplémentaire d’assurance qui renforce la reconnaissance mondiale des résultats [4].
Réduire l’empreinte carbone grâce à l’éco-conception
L’éco-conception représente une stratégie efficace pour minimiser l’empreinte carbone des produits tout en respectant les exigences de la norme ISO 14067. Cette approche préventive permet d’intégrer les considérations environnementales dès la conception du produit plutôt que de tenter de corriger les problèmes après leur apparition.
Choix de matériaux recyclables et biosourcés
La sélection judicieuse des matériaux constitue un levier majeur pour réduire l’impact carbone. Les matériaux biosourcés, issus de la biomasse, présentent généralement une empreinte carbone inférieure à celle de leurs homologues pétrosourcés. Par exemple, l’utilisation de bioplastiques à base d’amidon permet de réduire les émissions de GES de 30 à 80% par rapport aux plastiques conventionnels. De même, les matériaux recyclés comme l’aluminium secondaire nécessitent jusqu’à 95% moins d’énergie que l’aluminium primaire.
Optimisation des processus de fabrication
L’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels contribue significativement à la réduction des émissions. Cela inclut notamment :
- L’adoption de technologies énergétiquement efficientes
- La récupération de chaleur résiduelle
- L’utilisation d’énergies renouvelables pour l’alimentation des usines
Par ailleurs, la réduction des déchets de production et l’optimisation des flux de matières premières permettent également de diminuer l’empreinte carbone globale du produit.
Réduction des emballages et transport bas carbone
Les emballages représentent parfois jusqu’à 40% de l’empreinte carbone d’un produit. Leur optimisation (réduction du poids, utilisation de matériaux recyclés, conception facilitant le recyclage) est donc primordiale. En outre, privilégier des modes de transport à faibles émissions comme le rail ou le maritime plutôt que l’aérien peut réduire l’impact carbone du transport de marchandises de 90%.
Allongement de la durée de vie et réparabilité
Un produit conçu pour durer et être facilement réparé divise mécaniquement son empreinte carbone sur une période plus longue. Ainsi, augmenter la durée de vie d’un appareil électronique de 33% peut réduire son impact climatique d’environ 20%. La modularité, la standardisation des pièces détachées et la facilité de démontage constituent des aspects essentiels pour garantir la réparabilité et, par conséquent, la durabilité des produits.
Communiquer efficacement les résultats environnementaux
Une fois l’empreinte carbone d’un produit calculée selon la norme ISO 14067, la communication transparente des résultats devient primordiale pour valoriser cette démarche environnementale. Plusieurs outils permettent de partager ces informations de façon crédible et pertinente.
Déclaration environnementale de produit (DEP)
Les déclarations environnementales de produit (DEP) constituent un moyen standardisé de communiquer les performances environnementales d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie [23]. Basées sur la norme ISO 14025, elles offrent des informations transparentes, vérifiées et comparables [23]. Contrairement à l’ISO 14067 qui se concentre uniquement sur l’empreinte carbone, les DEP incluent de multiples indicateurs environnementaux – jusqu’à 30 indicateurs obligatoires pour les produits de construction [24]. Par ailleurs, elles suivent des Règles de Catégorie de Produit (PCR) spécifiques garantissant la comparabilité au sein d’une même catégorie de produits [24]. En France, l’enregistrement d’une DEP dans la base de données nationale est obligatoire avant toute revendication environnementale sur un produit [25].
Utilisation d’écolabels reconnus
Les écolabels officiels ajoutent une couche supplémentaire de crédibilité aux efforts environnementaux. L’EU Ecolabel, seul écolabel européen de type I selon ISO 14024, évalue les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie [8]. Vérifié par des experts indépendants, il garantit des performances environnementales supérieures [8]. Pour les aspects spécifiquement liés au carbone, des labels comme Carbon Neutral Certification ou Carbon Reduction Label certifient les produits ayant mesuré et réduit leur empreinte carbone [26]. Ces écolabels aident les consommateurs à identifier facilement les produits durables, 76% des Français se déclarant engagés dans une consommation responsable [22].
Éviter le greenwashing avec des données vérifiables
Face aux accusations croissantes de greenwashing, 42% des consommateurs estimant que les marques exagèrent leurs efforts environnementaux [27], la vérification des données selon ISO 14067 devient essentielle. Pour éviter les écueils des allégations trompeuses, mieux vaut privilégier des termes précis et mesurables plutôt que des formulations vagues comme « écologique » [25]. La future directive européenne sur les allégations vertes exigera d’ailleurs des preuves scientifiques au niveau des produits, utilisant des normes reconnues comme ISO 14067 [28]. Ainsi, la vérification par un tiers indépendant renforce considérablement la crédibilité des communications environnementales [4].
Conclusion
À l’heure où la transition écologique devient un impératif pour toutes les entreprises, la norme ISO 14067 s’affirme donc comme un outil stratégique essentiel. Cette méthodologie rigoureuse permet effectivement aux organisations de quantifier précisément l’empreinte carbone de leurs produits tout au long du cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la fin de vie.
La mise en œuvre de cette norme offre certainement de nombreux avantages. Elle aide les entreprises à identifier les « points chauds » d’émissions, optimiser leurs processus de fabrication et répondre aux attentes grandissantes des consommateurs. Ces derniers, de plus en plus conscients des enjeux environnementaux, exigent désormais une transparence totale sur l’impact climatique des produits qu’ils achètent.
L’application de l’ISO 14067 nécessite néanmoins une démarche méthodique passant par plusieurs étapes clés : définition précise des frontières du système, collecte rigoureuse des données d’inventaire, calcul avec des outils adaptés et vérification par un organisme indépendant. Cette approche structurée garantit des résultats fiables et comparables.
Au-delà du simple calcul, la norme constitue également un tremplin vers l’éco-conception. Les entreprises peuvent ainsi repenser leurs produits en privilégiant des matériaux recyclables ou biosourcés, en optimisant les processus de fabrication, en réduisant les emballages et en prolongeant la durée de vie des produits.
Par ailleurs, communiquer efficacement sur ces efforts environnementaux s’avère tout aussi important que la démarche elle-même. Les déclarations environnementales de produit (DEP) et les écolabels reconnus permettent de valoriser cette démarche auprès des parties prenantes sans tomber dans le piège du greenwashing.
Face aux défis climatiques actuels, l’ISO 14067 représente finalement bien plus qu’une simple norme : elle incarne un levier de transformation pour les entreprises souhaitant réduire leur impact environnemental et répondre aux exigences croissantes des consommateurs, des investisseurs et des régulateurs.
En bref
La norme ISO 14067 offre une méthodologie scientifique rigoureuse pour mesurer et réduire l’empreinte carbone des produits, devenant un outil stratégique indispensable face aux défis climatiques actuels.
• Méthodologie complète : L’ISO 14067 évalue les émissions CO₂e sur tout le cycle de vie produit, de l’extraction des matières premières à la fin de vie
• Démarche structurée en 4 étapes : Définir les frontières système, réaliser l’inventaire GES, calculer avec un logiciel dédié, faire vérifier par un tiers indépendant
• Levier d’éco-conception : Utiliser matériaux biosourcés/recyclés, optimiser les processus, réduire emballages et allonger la durée de vie produit
• Communication transparente : Éviter le greenwashing avec des DEP vérifiées et des écolabels reconnus pour valoriser les efforts environnementaux
• Impact business concret : Identifier les « points chauds » d’émissions permet d’optimiser les coûts tout en répondant aux attentes de 76% des Français engagés dans la consommation responsable
Cette norme représente bien plus qu’un simple calcul : elle constitue un véritable levier de transformation pour les entreprises souhaitant réduire leur impact climatique et répondre aux exigences croissantes des consommateurs, investisseurs et régulateurs dans un contexte où nous devons réduire nos émissions de 27 à 43% d’ici 2030.
FAQs
Q1. Qu’est-ce que la norme ISO 14067 et à quoi sert-elle ? La norme ISO 14067 est un cadre méthodologique international pour mesurer l’empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie. Elle permet aux entreprises de quantifier et réduire l’impact climatique de leurs produits de manière standardisée.
Q2. Quelles sont les principales étapes pour mettre en œuvre l’ISO 14067 ? Les étapes clés sont : définir les frontières du système étudié, réaliser l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre, calculer l’empreinte carbone avec un logiciel dédié, et faire vérifier les résultats par un organisme indépendant.
Q3. Comment l’éco-conception peut-elle aider à réduire l’empreinte carbone selon l’ISO 14067 ? L’éco-conception permet de réduire l’empreinte carbone en choisissant des matériaux recyclables et biosourcés, en optimisant les processus de fabrication, en réduisant les emballages, et en allongeant la durée de vie des produits.
Q4. Quels sont les avantages d’utiliser la norme ISO 14067 pour une entreprise ? La norme aide les entreprises à identifier les points critiques d’émissions, à optimiser leurs processus, à répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence environnementale et à se conformer aux réglementations émergentes sur le climat.
Q5. Comment communiquer efficacement les résultats d’une analyse selon l’ISO 14067 ? Pour une communication crédible, il est recommandé d’utiliser des déclarations environnementales de produit (DEP) vérifiées, des écolabels reconnus et de s’appuyer sur des données vérifiables pour éviter les accusations de greenwashing.
Bénéficiez d’une démo personnalisée de notre outil !
Nos consultants spécialisés accompagnent les studios de production pour cadrer la stratégie, former les équipes et suivre les résultats. Nous adaptons l’approche aux contraintes du terrain.