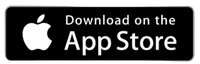Les émissions carbone dans l’audiovisuel, c’est un peu comme les coulisses d’un film : on ne les voit pas toujours, mais elles sont bien là ! Pour comprendre où et comment une production génère du CO₂, il faut s’intéresser aux 3 scopes d’émission.
📢 Spoiler alert : Oui, les caméras et les lumières polluent, mais le plus gros impact ne vient pas toujours d’où on l’imagine…
Dans cet article, on vous explique simplement et concrètement les scopes 1, 2 et 3, et surtout ce que ça signifie pour une production audiovisuelle 🎥
Table des matières
C’est quoi, les scopes d’émissions ?
Les scopes d’émission sont des catégories utilisées pour classer les émissions de gaz à effet de serre générées par une activité humaine dans un bilan carbone. Ils permettent d’identifier l’origine des émissions :
- Scope 1 : émissions directes produites par l’activité elle-même (ex : combustion de carburant sur site).
- Scope 2 : émissions indirectes liées à la consommation d’énergie achetée (ex : électricité, chauffage).
- Scope 3 : émissions indirectes plus larges, englobant l’ensemble des impacts en amont et en aval (ex : transport, fabrication des matériaux, gestion des déchets).
Le scope 3 représente plus de 80% des émissions carbone d’une organisation, car il prend en compte l’ensemble des émissions sur toute la chaîne de valeur d’un produit ou d’une activité. Cependant, il peut être complexe à mesurer et standardiser. Pour éviter que certaines émissions ne soient volontairement omises, différentes méthodologies ont été mises en place afin d’harmoniser les calculs et garantir une évaluation fiable.
Les scopes ont été définis entre 1998 et 2011 dans le cadre du Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), qui est aujourd’hui l’un des référentiels les plus utilisés à l’échelle mondiale pour le reporting des émissions carbone.
Voici comment s’organise les différents scopes d’émissions dans le cas particulier d’une production de film ⤵️
Scope 1
🚗 Les trajets de l’équipe
🔋 Les générateurs sur le tournage
Scope 2
⚡ L’énergie utilisée pour alimenter le plateau et les locaux annexes
Scope 3
📦 Le transport de matériel
🎥 La fabrication du matériel de prise de vue
📢 L’impact de la promotion du film
🎟️ Les trajets des spectateurs pour aller au cinéma
🍽️ L’impact des repas de la cantine et de la table
👗 La fabrication des décors et costumes
Etc…
Scope 1 : les émissions directes
👉 Le scope 1 regroupe toutes les émissions directement générées par la production audiovisuelle, c’est-à-dire celles liées à l’usage de combustibles fossiles sur le tournage.
Ces émissions proviennent principalement des véhicules de production, des générateurs et des équipements techniques fonctionnant avec du carburant. Par exemple, les camions transportant le matériel, les véhicules utilisés par l’équipe pour se rendre sur site ou encore les groupes électrogènes alimentant un tournage en extérieur entrent dans cette catégorie.
Les productions qui utilisent des effets spéciaux physiques, comme des explosions ou des flammes réelles, génèrent également des émissions de scope 1, puisqu’elles nécessitent l’utilisation de produits inflammables.
📉 Comment réduire ces émissions ?
Il est possible d’opter pour des alternatives plus durables, comme le recours à des véhicules électriques ou hybrides, l’utilisation de batteries rechargeables au lieu des générateurs diesel, ou encore une meilleure organisation logistique pour réduire les déplacements inutiles.
Scope 2 : les émissions indirectes liées à l’énergie
👉 Le scope 2 concerne les émissions indirectes liées à l’énergie, achetées et consommées sur le tournage et dans les locaux annexes.
Cela inclut l’électricité utilisée pour éclairer les plateaux, faire fonctionner les équipements audiovisuels, ou encore alimenter les bureaux de production et de post-production. Un studio tournant en intérieur, par exemple, peut nécessiter une consommation énergétique très élevée pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation et les serveurs de stockage des rushes.
Si l’énergie provient d’un mix énergétique comprenant des énergies fossiles (charbon, gaz, fioul), son impact carbone sera plus élevé. À l’inverse, si la production utilise de l’électricité issue de sources renouvelables (solaire, éolien, hydraulique), les émissions du scope 2 peuvent être considérablement réduites.
📉 Comment réduire ces émissions ?
Pour agir sur ce levier, les productions peuvent privilégier des studios équipés en énergies vertes, optimiser leur consommation grâce à des éclairages LED et limiter les équipements énergivores.
Scope 3 : les autres émissions indirectes
👉 Le scope 3 est de loin le plus vaste et souvent le plus conséquent en termes d’impact carbone, puisqu’il regroupe toutes les émissions indirectes liées à la production, en dehors de l’énergie directement consommée.
Cela englobe le transport du matériel, la fabrication des équipements de prise de vue (caméras, objectifs, drones), mais aussi des décors et costumes utilisés pour le tournage. La gestion des déchets générés par les tournages, souvent jetés après utilisation, fait également partie de cette catégorie.
Au-delà de la production elle-même, le scope 3 comprend aussi des éléments post-tournage, comme la promotion du film, les déplacements des équipes pour les avant-premières et festivals, ou encore le stockage des données numériques. Un autre aspect souvent sous-estimé est l’impact du public : les trajets des spectateurs pour aller voir un film au cinéma représentent une part significative des émissions globales d’une production.
📉 Comment réduire ces émissions ?
Il est possible d’agir à plusieurs niveaux : mutualiser les transports, encourager des solutions plus éco-responsables dans la restauration (ex. limiter les emballages jetables et privilégier des produits locaux), réutiliser et recycler les décors et costumes, ou encore optimiser l’utilisation des data centers pour le stockage numérique.
Qui est concerné par ces scopes d’émissions ?
Si jusqu’en 2023, les entreprises de plus de 500 salariés pouvaient se limiter aux scopes 1 et 2, elles doivent désormais intégrer le scope 3, qui englobe l’ensemble des émissions indirectes générées tout au long de leur chaîne de valeur.
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est une directive européenne entrée en vigueur en 2024, avec une mise en place progressive jusqu’en 2028. Elle impose aux entreprises éligibles de se conformer à de nouvelles obligations de reporting en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG) ⚖️
Dès 2025, pour leur reporting de l’année 2026, les entreprises concernées par la CSRD doivent remplir au moins deux des trois critères suivants :
- Un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros
- Un effectif dépassant 250 salariés
- Un total de bilan excédant 25 millions d’euros
Les PME cotées sur un marché réglementé en Europe (hors micro-entreprises) devront, quant à elles, appliquer la directive dès 2027, avec une période transitoire de deux ans pour faciliter leur adaptation.
L’enjeu spécifique du scope 3
Le scope 3 est un levier clé dans la réduction des émissions à l’échelle globale, car il englobe l’ensemble des impacts indirects d’une entreprise, tout au long de sa chaîne de valeur ; chaque entreprise est, à son tour, le scope 3 d’une autre 🔄
Même sans obligation réglementaire, réaliser un bilan carbone intégrant le scope 3 devient incontournable. D’une part, cela permet de répondre aux exigences des clients et partenaires soumis aux nouvelles réglementations. D’autre part, cette démarche offre un avantage concurrentiel en permettant aux entreprises de mieux comprendre, maîtriser et réduire leur impact environnemental.
Intégrer le scope 3 dans une stratégie bas-carbone ne relève donc pas uniquement de la conformité, mais d’une vision à long terme alignée avec les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 et avec une politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de plus en plus attendue par le marché 🚀
Comment mesurer ses émissions indirectes ?
Si mesurer les émissions directes d’une production est relativement simple, quantifier les émissions indirectes (scope 3) reste un véritable défi. Il n’existe pas de méthode unique, car le calcul repose sur de nombreuses données dispersées, provenant des transports, des hébergements, des matériaux utilisés, ou encore de la consommation numérique.
Dans l’audiovisuel, cela signifie prendre en compte l’ensemble des impacts d’un projet, depuis la construction des décors jusqu’à la diffusion d’un film ou d’une série 🎬
Selon l’Ademe, seulement 9% des entreprises déclarent avoir la capacité d’estimer leur scope 3 avec précision.
Pour structurer cette démarche, plusieurs calculateurs carbone spécifiques au secteur ont été développés. Carbon’Clap, Albert et Peach Pear Plum permettent d’estimer l’empreinte carbone des productions en suivant des méthodologies reconnues, comme le GHG Protocol ou le Bilan Carbone®. Ces outils sont essentiels pour identifier les postes les plus émetteurs et mettre en place des actions de réduction adaptées.
Mais la collecte de données reste une étape fastidieuse et chronophage. Un facilitateur comme GreenPro permet d’automatiser la récupération et le traitement des données carbone. En intégrant directement les informations issues des factures, des budgets ou des feuilles de service, cet outil simplifie le suivi et évite les erreurs liées à la saisie manuelle ✅
Il assure également une traçabilité fiable et facilite la réalisation du rapport extra-financier, un atout précieux pour répondre aux exigences de la CSRD et engager des actions concrètes de réduction d’impact.
Rencontrez un expert pour découvrir la solution
Le projet de scope 4, les émissions évitées
Depuis plusieurs années, certains experts suggèrent d’aller plus loin en intégrant un “scope 4”, qui correspondrait aux émissions de CO₂ évitées grâce à des solutions plus durables. L’idée est de mesurer l’impact positif d’un produit ou d’un service lorsqu’il remplace une alternative plus polluante 👌
Par exemple, une entreprise qui développe des équipements économes en énergie, des systèmes de recyclage avancés ou encore des solutions de visioconférence permettant d’éviter des déplacements pourrait valoriser ces actions dans son bilan carbone. L’ADEME en France et l’EFRAG en Europe encouragent cette réflexion, même si aucune méthodologie officielle n’a encore été standardisée.
Les entreprises qui défendent ce projet identifient trois types d’émissions évitées :
1️⃣ Remplacer une solution polluante par une alternative moins émettrice
2️⃣ Réduire ses émissions en investissant dans des solutions bas-carbone
3️⃣ Financer des projets durables en lien avec la décarbonation
Même si le scope 4 n’est pas encore reconnu officiellement, il ouvre la voie à une nouvelle approche du bilan carbone, où les entreprises pourraient non seulement réduire leurs émissions, mais aussi mettre en avant leurs contributions positives à la transition écologique.