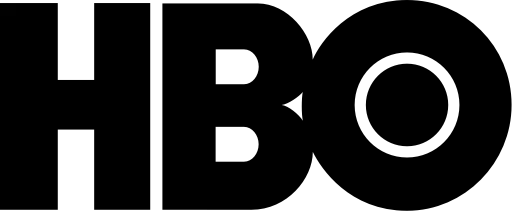Le continent de plastique vu depuis l’espace révèle une réalité bien plus alarmante que ce que l’on pourrait imaginer. S’étendant sur environ 3,43 millions de km², soit l’équivalent de six fois la France ou d’un tiers de l’Europe, cette immense accumulation de déchets plonge jusqu’à 30 mètres sous la surface de l’océan. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas d’une île solide visible depuis l’espace.
En effet, les images satellite du 7ème continent sont trompeuses et ne montrent pas directement cette pollution massive. Pourtant, cette zone contient près de 3,5 millions de tonnes de déchets, ce qui représente cinq fois plus de plastique que de plancton. La vue satellite du continent plastique ne révèle pas l’ampleur de cette catastrophe écologique qui affecte plus de 267 espèces marines. De plus, selon Greenpeace, environ un million d’oiseaux et cent mille mammifères marins meurent chaque année après avoir ingéré ces plastiques.
Ce phénomène s’aggrave à un rythme alarmant. Entre 1999 et 2010, la concentration de microplastiques a été multipliée par cent , tandis que la taille du continent de plastique a été multipliée par cent au cours des quarante dernières années . Sans intervention humaine, il faudrait environ 400 ans pour que ce continent de plastique se dégrade entièrement .
Autopsie du continent de plastique en 2025
Taille réelle et profondeur estimée
En 2025, le vortex de déchets du Pacifique Nord présente des dimensions qui varient considérablement selon les sources scientifiques. Découvert par l’océanographe Charles Moore en 1997, ce phénomène ne cesse de s’étendre. Selon l’Ocean Campus, sa superficie atteint 3,43 millions de km², soit l’équivalent de six fois la France ou un tiers de l’Europe [1]. D’autres estimations sont plus conservatrices, variant entre 1,4 million et 2 millions de km² [1]. En 2018, l’organisation Ocean Cleanup évaluait sa taille à 1,6 million de km² [2].
Cette masse de déchets s’étend sur une profondeur moyenne de 10 mètres, mais peut atteindre par endroits jusqu’à 30 mètres sous la surface [1]. Si ces débris flottants étaient ramassés, leur masse totale s’élèverait à environ 80 000 tonnes [2]. Par ailleurs, la concentration de plastique y est alarmante – l’océanographe Charles Moore a mesuré une moyenne de 334 000 déchets par km², avec des variations allant de 32 000 à 1 million de pièces par km² [1].
En certains endroits, la quantité de plastiques est six fois supérieure à celle du plancton, premier maillon essentiel à la vie océanique [1]. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement, ce vortex contiendrait près de 3,5 millions de tonnes de déchets, représentant cinq fois plus de plastique que de plancton [1].
Pourquoi il est invisible depuis l’espace
Contrairement aux idées reçues, ce « 7e continent » n’est pas une île solide mais plutôt une « soupe de plastique » constituée principalement de micro-fragments. Cette caractéristique explique son invisibilité depuis l’espace. En effet, la mer de déchets est translucide et se situe juste sous la surface de l’eau, la rendant indétectable sur les photographies prises par satellites [1].
L’océanographe français François Galgani de l’Ifremer précise qu’il s’agit « d’une multitude de micro-plastiques, d’un diamètre inférieur à 5 mm, en suspension à la surface ou jusqu’à 30 mètres de profondeur, difficiles à voir de loin » [3]. Ce phénomène est d’autant plus pernicieux qu’il est invisible, comme le souligne Patrick Deixonne : « Étant donné que les gens ne voient pas cette soupe de plastique, ils n’ont aucune notion de ce désastre écologique » [3].
Néanmoins, une étude de l’organisation Ocean Cleanup publiée dans Scientific Reports révèle que les trois-quarts des débris dépassent les 5 cm, et près de la moitié sont du matériel de pêche abandonné [2]. Ceci constitue « plutôt une bonne nouvelle » car « les gros débris sont bien plus faciles à collecter que les microplastiques » [2].
Vue satellite du 7e continent : ce qu’on peut vraiment voir
Si les satellites ne peuvent pas détecter directement ces déchets, ils contribuent toutefois à la compréhension et au suivi du phénomène. Depuis septembre 2017, l’Agence spatiale européenne teste la détection des déchets plastiques depuis Sentinel 3A, en orbite à environ 800 kilomètres d’altitude [4]. Ce satellite a la particularité d’observer la couleur de l’eau, seul moyen d’étudier la subsurface des océans [4].
L’approche ne consiste pas à repérer des déchets flottants individuels, mais plutôt à identifier une « signature spectrale » du plastique. Comme l’explique Paolo Corradi de l’ESA : « nous parlons d’identifier une signature spectrale du plastique prélevée sur orbite, de la même manière qu’un logiciel de traitement peut aujourd’hui détecter des concentrations de phytoplancton » [4]. Cette technologie est actuellement utilisée dans les usines de recyclage pour séparer différents types de plastique [5].
Les cartes satellite des courants océaniques servent également à anticiper la destination des déchets dans les océans [5]. Pour optimiser la recherche, l’expédition « 7e continent » utilise le réseau Mercator Océan qui décrit l’état de l’océan grâce à des bouées dérivantes et des satellites [6]. Ce système permet de localiser précisément le cœur du gyre, là où les concentrations de plastique sont potentiellement les plus élevées.
À l’avenir, l’ESA pourrait développer un satellite dédié observant dans l’infrarouge [4], capable de cartographier précisément les déchets plastiques flottants. Cet outil serait crucial pour évaluer l’évolution de cette pollution, dont la concentration a été multipliée par cent au cours des quarante dernières années dans le gyre du Pacifique Nord [6].
Origine et composition des déchets
Déchets domestiques et industriels
La pollution du continent de plastique résulte principalement d’une mauvaise gestion des déchets terrestres. En effet, environ 80% des déchets retrouvés en mer sont d’origine terrestre [7]. La production mondiale de plastique a connu une augmentation alarmante, passant de 234 millions de tonnes en 2000 à 460 millions de tonnes en 2019 [8]. Parmi ces déchets, seuls 9% sont recyclés, 19% incinérés et 50% finissent dans des décharges [8].
Plusieurs secteurs économiques contribuent de manière significative à cette pollution. Le tourisme est responsable de 40% de la pollution plastique en mer Méditerranée, tandis que la distribution génère environ 40% de tous les plastiques produits, principalement sous forme d’emballages [9]. L’agriculture et la construction sont également d’importants contributeurs, avec leurs tuyaux d’irrigation, pastilles fertilisantes et matériaux de construction [9].
Les pays les plus contributeurs
Les nations asiatiques figurent en tête des plus grands pollueurs océaniques. Les Philippines arrivent au premier rang avec plus de 350 000 tonnes de déchets plastiques déversés annuellement dans les océans [10]. Elles sont suivies par l’Inde (126 000 tonnes), la Malaisie (73 000 tonnes) et la Chine (70 000 tonnes) [10].
Concernant le continent de plastique du Pacifique Nord spécifiquement, une étude révèle que six pays sont responsables de 92% des déchets identifiables : le Japon (34%), la Chine (32%), la Corée (10%), les États-Unis (7%), Taïwan (6%) et le Canada (5%) [11].
Le rôle des gyres océaniques
Les gyres océaniques jouent un rôle déterminant dans l’accumulation des déchets plastiques. Ces vastes tourbillons sont créés par la rotation de la Terre et les courants marins [1]. Ils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord et en sens inverse dans l’hémisphère sud, piégeant inexorablement les déchets plastiques [1].
Il existe cinq principales zones d’accumulation dans le monde : dans les océans Pacifique Nord et Sud, Atlantique Nord et Sud, et dans l’océan Indien [12]. Le gyre du Pacifique Nord, le plus vaste, s’étend sur 1,6 million de km² [1], tandis que celui de l’Atlantique nord couvre une superficie de deux à trois fois la France [1].
Matériel de pêche et microplastiques
Les débris issus de l’industrie de la pêche représentent une part importante du continent plastique. Bien qu’ils ne constituent que 20% du décompte total des déchets, ils représentent 70% du poids total, dominés par les bouées et balises flottantes [9]. Environ 640 000 tonnes de matériel de pêche se retrouvent dans les océans chaque année [13], continuant à piéger les animaux marins dans ce qu’on appelle la « pêche fantôme » [13].
Quant aux microplastiques, ils constituent 94% du nombre total de déchets dans le gyre du Pacifique, mais seulement 8% de la masse totale [14]. Ces particules inférieures à 5 mm [15] proviennent soit directement de produits industriels (microplastiques primaires), soit de la dégradation de plus grands déchets (microplastiques secondaires) [1]. Leur concentration a atteint des niveaux alarmants, avec jusqu’à 10 millions de microparticules par km² en 2022, dix fois plus qu’en 2015 [16].
Conséquences écologiques et sanitaires
L’accumulation massive de plastique dans nos océans engendre des bouleversements profonds pour les écosystèmes marins, dont les effets se répercutent jusqu’à nous.
Espèces invasives et déséquilibres biologiques
Les débris flottants du continent de plastique servent de véritables radeaux pour certains organismes marins. Ces déchets transportent divers invertébrés sur des milliers de kilomètres, bien au-delà de leurs zones naturelles de répartition [17]. Des études ont identifié 37 espèces d’invertébrés originaires principalement du Japon sur des déchets prélevés entre la Californie et Hawaï [3]. Ces organismes se développent rapidement en se nourrissant des couches de mucus formées par les bactéries et algues sur les plastiques [3].
L’impact est considérable : l’araignée d’eau (Halobates sericeus) utilise ces supports pour pondre, menaçant l’équilibre des écosystèmes en se nourrissant de phytoplancton et d’œufs de poissons [18]. En Europe, des moules vertes asiatiques et des huîtres creuses ont été observées sur des débris flottants, introduisant potentiellement des espèces envahissantes [17].
Dangers pour les animaux marins
Les conséquences pour la faune marine sont dévastatrices. Environ 90% des animaux marins ont déjà ingéré du plastique [19]. Chaque année, la pollution plastique tue plus d’un million d’animaux marins, affectant près de 700 espèces différentes [19].
Les macro-plastiques provoquent étouffements et occlusions intestinales [4]. Les albatros nourrissent accidentellement leurs petits avec des débris plastiques [5], tandis que presque toutes les tortues marines ont désormais du plastique dans l’estomac [19]. Les gros déchets réduisent également la quantité de lumière atteignant les coraux et algues [20].
Microplastiques dans la chaîne alimentaire
Les microplastiques, particulièrement insidieux, contaminent l’ensemble de la chaîne alimentaire. Sous l’action du soleil, du sel et des bactéries, le plastique se fragmente en particules de plus en plus petites [20]. Ces débris sont ingérés par le zooplancton, les poissons et les organismes filtreurs comme les huîtres [4].
Par ailleurs, ces fragments contiennent des additifs chimiques qui perturbent le système endocrinien des espèces marines [4]. L’huître creuse, par exemple, voit sa reproduction affectée après exposition aux microplastiques [18]. Plus inquiétant encore, les particules inférieures à 50 nanomètres peuvent franchir la membrane digestive des poissons et entrer dans leur système sanguin [4].
Impact sur le phytoplancton et l’oxygène
Peut-être la conséquence la plus alarmante concerne l’oxygène que nous respirons. Les microplastiques menacent les prochlorococcus, bactéries qui produisent à elles seules 10% de l’oxygène terrestre [21]. Les polluants comme les phtalates, le zinc ou le nickel perturbent leur photosynthèse et peuvent même les tuer [21].
En outre, la consommation de microplastiques par le zooplancton réduit la pression exercée sur les producteurs primaires, créant des proliférations d’algues qui consomment l’oxygène disponible [22]. Ce phénomène contribue à la formation de « zones mortes » – portions d’océan dépourvues d’oxygène où les poissons fuient et la faune peu mobile meurt [20]. Leur nombre est passé de 40 dans les années 1960 à plus de 500 en 2024 [20].
Peut-on vraiment le nettoyer ?
Face à l’ampleur du désastre, diverses solutions émergent pour tenter de nettoyer ce continent invisible vu du ciel.
Technologie Ocean Cleanup : promesses et limites
L’organisation néerlandaise Ocean Cleanup développe depuis 2013 des technologies innovantes pour extraire les plastiques des océans. Son système phare, un dispositif de barrières flottantes de 2,2 km de longueur, est conçu pour capturer passivement les débris [23]. L’ONG ambitionne de déployer au moins dix systèmes permettant d’éliminer jusqu’à 50% du vortex du Pacifique Nord en cinq ans [2].
Cependant, malgré ces efforts, l’organisation n’a collecté qu’environ 500 tonnes de déchets, soit à peine 0,5% du total flottant dans cette zone [6]. Plus inquiétant encore, une étude d’Ocean Cleanup révèle que la concentration de microplastiques a décuplé entre 2015 et 2022, avec jusqu’à 10 millions de microparticules par km² [24].
Autres initiatives : Ocean Voyages, Abundant Seas
D’autres acteurs s’engagent également. Ocean Voyages Institute a récupéré plus de 850 000 livres (environ 385 tonnes) de débris plastiques lors de dix expéditions [25]. En 2020, ils ont réalisé le plus grand nettoyage en haute mer de l’histoire en récupérant 340 000 livres (170 tonnes) de plastiques [25].
Par ailleurs, des organisations comme Abundant Seas et The Sea Cleaners complètent ces actions, notamment en développant des infrastructures de tri dans des pays comme l’Indonésie [6].
Critiques scientifiques : faut-il préserver ce nouvel écosystème ?
Néanmoins, un débat émerge parmi les scientifiques. Certains chercheurs, dont l’écologue Rebecca Helm, s’opposent au nettoyage total, arguant que « ces projets pourraient priver le monde d’un écosystème entier que nous ne comprenons pas » [26]. En effet, le continent de plastique est devenu un véritable laboratoire où cohabitent des espèces qui n’auraient jamais dû se rencontrer, 80% d’entre elles provenant des zones côtières [27].
Cette position reste toutefois controversée face à l’urgence écologique. Comme le résume un expert, « si les efforts de nettoyage sont précieux, empêcher les plastiques d’entrer dans les océans reste une priorité beaucoup plus grande » [28].
Sensibilisation et actions citoyennes
Face à l’invisibilité du continent plastique depuis l’espace, diverses initiatives mobilisent le public pour rendre ce désastre écologique concret et actionnable.
Expéditions et traversées pour alerter
L’association Expédition 7e Continent, créée par Patrick Deixonne après sa traversée de l’Atlantique en 2009, mène un combat déterminé contre la pollution plastique. Cette organisation combine expertises scientifiques et pédagogiques pour comprendre et faire comprendre ce fléau [29]. Avec sa goélette de 27 mètres, l’équipe organise régulièrement des expéditions scientifiques en Méditerranée, notamment pour étudier l’impact des perturbateurs transportés par les plastiques fragmentés [16]. Parallèlement, Plastic Odyssey parcourt l’océan Indien dans le cadre du projet ExPLOI, mobilisant une vingtaine de scientifiques pour améliorer les connaissances sur cette pollution [30].
Éducation dans les écoles et sur les plages
La sensibilisation des jeunes constitue un pilier essentiel. En 2024, l’association 7e Continent a organisé des tournées pédagogiques dans huit villes de la région PACA, proposant gratuitement des ateliers aux scolaires [31]. La Fondation Tara Océan a développé « la fresque de la pollution plastique », un outil collaboratif utilisé par plus de 1500 enseignants depuis septembre 2023 [32]. D’autres initiatives comme « Plastique à la loupe » permettent aux élèves de contribuer directement à la recherche scientifique en collectant des échantillons sur les plages [33].
Comment chacun peut réduire sa pollution plastique
Chaque citoyen peut agir concrètement pour limiter sa contribution au continent plastique. Parmi les gestes efficaces:
- Remplacer les bouteilles jetables par des gourdes réutilisables, sachant qu’un million de bouteilles plastiques sont achetées chaque minute dans le monde [34]
- Participer aux opérations de nettoyage comme la Journée mondiale du nettoyage, qui a mobilisé 170 000 personnes en France en 2022 [35]
- Privilégier les produits sans emballage ou en vrac, alors que les emballages représentent 40% de la production mondiale de plastique [34]
- Éviter les produits de soins personnels contenant des microplastiques qui se déversent directement dans les océans [36]
Comme le souligne l’ONG 7e Continent : « Quand les déchets plastiques sont en mer, il est trop tard. C’est en amont, à terre, à la source qu’il faut agir » [16].
Conclusion
Face à cette catastrophe écologique invisible depuis l’espace, nous devons désormais agir collectivement. La situation du continent plastique s’aggrave à un rythme alarmant, sa concentration de microplastiques ayant décuplé en moins d’une décennie. Undoubtedly, cette soupe toxique menace non seulement plus de 700 espèces marines mais également le phytoplancton, source vitale d’oxygène pour notre planète.
Bien que des initiatives comme Ocean Cleanup et Ocean Voyages Institute s’attaquent courageusement au problème, leurs efforts demeurent insuffisants face à l’ampleur du désastre. Les 500 tonnes récupérées représentent à peine 0,5% du total des déchets flottants. Par conséquent, la prévention s’impose comme priorité absolue.
Certes, le débat scientifique persiste quant à la préservation de ce nouvel écosystème. Toutefois, les conséquences sanitaires pour l’ensemble de la chaîne alimentaire justifient une action immédiate et concertée. Les microplastiques franchissent désormais les barrières digestives des poissons pour atteindre leur système sanguin, avant de finir potentiellement dans nos assiettes.
Chaque citoyen peut contribuer significativement à la solution en remplaçant les plastiques à usage unique, en privilégiant les achats en vrac et en participant aux opérations de nettoyage. Pour autant, seule une transformation profonde de notre rapport au plastique permettra d’enrayer cette pollution massive.
La véritable solution réside donc à terre, pas en mer. Comme le rappelle si justement l’ONG 7e Continent, une fois les déchets en mer, il est déjà trop tard. Ensemble, nous pouvons encore empêcher ce continent invisible de devenir le symbole irréversible de notre négligence environnementale.
FAQs
Q1. Où se trouve le continent de plastique et quelle est sa taille ? Le continent de plastique se trouve principalement dans l’océan Pacifique Nord. Sa taille est estimée à environ 1,6 million de km², soit trois fois la superficie de la France métropolitaine.
Q2. Pourquoi ne peut-on pas voir le continent de plastique depuis l’espace ? Le continent de plastique n’est pas visible depuis l’espace car il est composé principalement de micro-fragments de plastique en suspension juste sous la surface de l’eau, formant une sorte de « soupe » translucide difficile à détecter sur les images satellites.
Q3. Quels sont les principaux dangers du continent de plastique pour la vie marine ? Le continent de plastique menace gravement la vie marine. Il provoque l’étouffement et l’occlusion intestinale chez de nombreux animaux, perturbe les écosystèmes en transportant des espèces invasives, et contamine la chaîne alimentaire avec des microplastiques toxiques.
Q4. Est-il possible de nettoyer entièrement le continent de plastique ? Bien que des initiatives comme Ocean Cleanup tentent de nettoyer le continent de plastique, l’ampleur du problème rend un nettoyage complet très difficile. Les efforts actuels n’ont permis de collecter qu’une infime partie des déchets. La prévention de la pollution plastique reste donc primordiale.
Q5. Comment puis-je contribuer à réduire la pollution plastique des océans ? Vous pouvez agir en utilisant des alternatives réutilisables aux plastiques à usage unique, en privilégiant les achats en vrac, en participant à des opérations de nettoyage des plages, et en évitant les produits contenant des microplastiques. Chaque geste compte pour réduire la pollution plastique à la source.
Nos consultants spécialisés accompagnent les studios de production pour cadrer la stratégie, former les équipes et suivre les résultats. Nous adaptons l’approche aux contraintes du terrain.