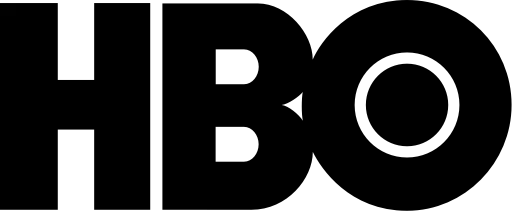- Répartition des émissions : où se situent l’avion et la voiture ?
- Voiture thermique contre électrique : quel impact carbone réel ?
- Avion : un mode de transport à fort impact climatique
- Comparaison CO2 avion-voiture : que disent les chiffres ?
- Alternatives bas carbone pour vos trajets
- Facteurs à considérer pour choisir son mode de transport
- Table de comparaison
- Conclusion
- FAQs
L’empreinte carbone de l’avion et de la voiture représente un enjeu majeur dans notre lutte contre le changement climatique. En France, le secteur du transport est responsable de 39% des émissions globales de CO2 , dont 30% sont attribuées aux seuls transports nationaux (soit 126 millions de tonnes de CO2e) . Face à ces chiffres alarmants, la question du choix entre ces deux modes de transport devient cruciale.
Par ailleurs, la comparaison du bilan carbone entre avion et voiture révèle des données surprenantes. Alors qu’une voiture à essence émet environ 218 gCO2e par kilomètre , l’avion génère 259 gCO2e par kilomètre et par passager . Cependant, ces chiffres varient considérablement selon plusieurs facteurs. En effet, la pollution liée au transport aérien et routier dépend notamment du nombre de passagers, de la distance parcourue et du type de véhicule utilisé. Un vol aller-retour Paris-New York, par exemple, émet quasiment 1,8 tonne de CO2 par passager , représentant ainsi 20% des émissions annuelles d’un Français moyen .
Que l’on parle d’émissions de CO2 pour un court trajet ou d’une comparaison des émissions entre avion et voiture sur une longue distance, les impacts environnementaux diffèrent. Cet article examine en détail les émissions respectives de ces deux modes de transport, leurs avantages et inconvénients, ainsi que les alternatives plus écologiques disponibles pour les voyageurs soucieux de réduire leur impact sur la planète.
Répartition des émissions : où se situent l’avion et la voiture ?
Le secteur des transports se positionne comme le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. Pour comprendre l’empreinte carbone des avions et voitures, il est essentiel d’examiner leur place respective dans le panorama des émissions nationales.
Part des transports dans les émissions nationales
En 2022, le secteur des transports a généré 130,5 millions de tonnes équivalentes de CO2, représentant 32% des émissions nationales de GES [1]. D’autres sources estiment cette contribution à 34% en 2023 [1], faisant du transport le secteur le plus émetteur, devant l’agriculture (19 %) et l’industrie manufacturière (18 %) [1].
Cette prédominance n’est pas nouvelle. En effet, depuis 1998, les transports constituent le premier poste contributeur aux émissions nationales [1]. Par ailleurs, la part des transports dans les émissions de GES nationales n’a cessé de croître au cours des dix dernières années [1]. Cela s’explique notamment par le fait que le transport est le seul secteur où les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté au cours des trois dernières décennies, avec une hausse de 33,5 % entre 1990 et 2019 [1].
Face à cette situation préoccupante, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) fixe l’objectif de réduire les émissions de GES du transport de 28% d’ici 2030 par rapport à 2015 [1] et vise une décarbonation totale des transports d’ici 2050 [1]. Néanmoins, pour tenir la trajectoire fixée pour 2030, il faudra réduire les émissions du transport de personnes cinq fois plus vite sur les cinq années à venir que ce qui a été obtenu ces cinq dernières années [1].
Poids respectif de l’avion et de la voiture dans le bilan carbone
Lorsqu’on analyse la comparaison du CO2 émis par l’avion ou la voiture, on constate que le transport routier domine largement le bilan carbone des transports. Ce dernier est responsable de 94% des émissions de GES du secteur [1], principalement en raison de la combustion de carburants fossiles (essence, gazole, GPL) [1].
La répartition des émissions de CO2 provenant de l’avion et de la voiture montre une disproportion significative :
- Les voitures particulières représentent 52 à 53% des émissions du secteur des transports [1][1][1]
- Les poids lourds contribuent à hauteur de 24-25% [1][1]
- Les véhicules utilitaires légers sont responsables de 15% [1][1]
- L’aviation ne représente qu’environ 3% selon certaines sources [2] ou 5% des émissions totales en tenant compte des transports internationaux [1]
Malgré sa faible part dans les émissions globales, l’impact de l’aviation n’est pas négligeable. Les émissions induites par les vols intérieurs et internationaux au départ de la France s’élevaient à 24,2 millions de tonnes de CO2e en 2019, soit 5,3 % des émissions globales de la France [2]. De plus, ces émissions ont progressé de 11,1 % entre 2022 et 2023 [1] et ont augmenté de 85% depuis 1990 [2].
En termes d’intensité carbone, la pollution “avion et voiture” présente des valeurs comparables par passager-kilomètre. Selon les estimations, l’avion émet environ 259 gCO2e par km et par passager [2], tandis que la voiture thermique avec un seul passager émet 196 gCO2e par passager-km [2]. Cependant, cette comparaison doit être nuancée, car sur les longues distances, il y a en moyenne 2,2 personnes par voiture [2], ce qui réduit considérablement l’empreinte par passager.
Le bilan carboneavion + voiture dépend donc fortement du nombre d’occupants et de la distance parcourue, mais aussi d’autres facteurs comme l’âge du véhicule, les conditions de circulation, ou encore le type de motorisation.
Voiture thermique contre électrique : quel impact carbone réel ?
Face à l’urgence climatique, la transition vers des véhicules plus propres est devenue prioritaire. En comparant l’empreinte carbone entre l’avion et la voiture, il est également essentiel d’analyser les différences entre voitures thermiques et électriques pour comprendre leur impact environnemental réel.
Émissions moyennes : 218 gCO2/km contre 103 gCO2/km
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une voiture à essence émet en moyenne 218 grammes de CO2 équivalent par kilomètre [3], tandis qu’un véhicule électrique n’en émet qu’environ 103 gCO2e/km [1]. Cette différence significative place la voiture électrique comme une alternative moins polluante, émettant deux fois moins de gaz à effet de serre que son homologue thermique.
Cette comparaison devient encore plus frappante lorsqu’on examine les données françaises. En effet, grâce à un mix électrique majoritairement décarboné (nucléaire et hydroélectricité), les émissions en phase d’utilisation d’une voiture électrique en France sont particulièrement faibles :
Selon certaines études, sur sa durée de vie complète, une voiture électrique émettrait 3 à 4 fois moins de CO2 qu’une voiture thermique en France [5]. D’autres sources plus conservatrices estiment cette réduction entre 2 et 3 fois [6].
Phase d’usage vs phase de fabrication
Néanmoins, la répartition des émissions entre les phases de vie du véhicule diffère radicalement. Pour les véhicules thermiques, 88% de l’empreinte carbone provient de la phase d’usage (principalement du carburant), contre seulement 12% pour la construction [1].
À l’inverse, pour les voitures électriques, la situation est diamétralement opposée : 81% des émissions sont liées à la phase de fabrication, contre seulement 19% à l’usage [1]. La fabrication de la batterie représente à elle seule 45% de l’empreinte carbone totale de production [7].
D’après l’ADEME, la production d’une voiture électrique émet environ 50% de CO2 de plus qu’une voiture thermique [4]. Cette « dette carbone » initiale se situe entre 5 et 15 tonnes équivalentes de CO2 selon les modèles [5].
Pour une citadine type B, la comparaison détaillée est révélatrice :
- Citadine électrique (type Renault Zoé) : 60 gCO2e/km (fabrication) + 15 gCO2e/km (utilisation) = 75 gCO2e/km au total [4]
- Citadine thermique (type Renault Clio) : 30 gCO2e/km (fabrication) + 160 gCO2e/km (utilisation) = 190 gCO2e/km au total [4]
Le « point de bascule » à partir duquel la voiture électrique devient plus écologique se situe entre 30 000 et 50 000 kilomètres parcourus [6]. Pour une berline compacte, ce seuil est estimé à environ 70 000 km [5].
Effet rebond et taille des véhicules
Un phénomène préoccupant vient toutefois nuancer ces avantages : l’effet rebond. Entre 1990 et 2007, la masse moyenne des voitures a augmenté de 30% [8]. Cette tendance aux véhicules plus lourds et plus grands (notamment les SUV) compromet sérieusement les gains écologiques potentiels.
L’ADEME pose ainsi une limite à 60 kWh pour la capacité de la batterie, au-delà de laquelle « l’intérêt environnemental n’est pas garanti » [5]. Un SUV électrique, par exemple, peut avoir une empreinte carbone deux fois supérieure à celle d’une petite citadine électrique sur sa durée de vie [6].
Par ailleurs, certains comportements peuvent annuler les bénéfices environnementaux : utilisation accrue due au coût de fonctionnement inférieur, remplacement de trajets à pied ou en transport en commun par la voiture électrique [5], ou encore l’achat de véhicules plus grands sous prétexte qu’ils sont électriques.
Enfin, rappelons que même si la voiture électrique présente un meilleur bilan carbone, elle ne résout pas tous les problèmes liés à l’automobile : occupation de l’espace, accidentalité et sédentarité [5]. La transition vers des véhicules électriques doit donc s’accompagner d’une réflexion plus large sur nos modes de mobilité.
Avion : un mode de transport à fort impact climatique
Pour comprendre l’empreinte carbone des avions et des voitures, il est crucial d’analyser en détail l’impact climatique du transport aérien, qui va bien au-delà des seules émissions de CO2.
Émissions moyennes : 259 gCO2/km
Selon les données de l’ADEME, l’avion émet en moyenne 259 gCO2e par kilomètre et par passager [1]. Cette valeur se décompose de façon révélatrice : la phase d’usage représente 99,8 % de cette empreinte carbone, tandis que la phase de construction ne compte que pour 0,15 % des émissions [1].
Pour être plus précis, la combustion du kérosène génère 3,01 kg de CO2 par litre [1]. Sur ce total, 84% du CO2 est émis lors de la phase de consommation (combustion directe), et 16% provient de la production et de la distribution du carburant (extraction, transport, raffinage) [1].
À titre comparatif, un aller-retour Paris-New York (environ 12 000 km) émet approximativement une tonne de CO2 par personne [9], soit l’équivalent des émissions annuelles moyennes d’un Français pour le chauffage de son domicile [9].
Effets hors CO2 : traînées de condensation et forçage radiatif
Néanmoins, la comparaison des émissions de CO2 avion-voiture ne s’arrête pas aux seules émissions directes. En effet, l’aviation génère des effets climatiques supplémentaires, notamment par les traînées de condensation.
Ces traînées blanches visibles dans le ciel représentent un impact climatique considérable. Bien qu’elles ne soient que de la vapeur d’eau émise par les moteurs, elles favorisent la formation de nuages cirrus qui contribuent significativement au réchauffement [10]. Ces nuages fins absorbent le rayonnement terrestre et le redirigent vers le sol au lieu de l’espace, emprisonnant ainsi la chaleur [10].
Des études scientifiques récentes estiment que les effets non-CO2 de l’aviation représentent environ 5% du forçage radiatif total dû aux activités humaines [11]. Plus précisément, le forçage radiatif des traînées de condensation et cirrus induits représenterait entre la moitié et trois fois le forçage exercé par les seules émissions de CO2 du secteur aérien [11].
Par ailleurs, selon certains experts, le forçage radiatif dont sont responsables ces émissions est important et même, en 2000, deux fois supérieur à celui du CO2 accumulé depuis les débuts de l’aviation [12].
Impact du fret aérien
Le transport de marchandises constitue également une part significative de la pollution liée aux voies aériennes et routières. Le fret aérien représente environ 15% des émissions totales de l’aviation, les 85% restants étant attribués au transport de personnes [2].
En 2019, 58 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par avion, parcourant en moyenne 3 900 km, pour un total de 228 milliards de tonnes-kilomètres [12]. Bien que cette quantité puisse sembler modeste, son impact environnemental est disproportionné : le fret aérien représente moins de 0,5% des marchandises transportées en Europe pour 10% des émissions associées au fret [2].
En termes d’efficacité, l’avion est particulièrement désavantageux pour le transport de marchandises : il est 25 fois plus émetteur que le camion et plus de 100 fois plus émetteur que le train ou le bateau [2]. Cette situation est d’autant plus préoccupante que le fret aérien a progressé de 19% entre 2020 et 2021, une tendance qui devrait se poursuivre selon l’Association internationale du transport aérien (IATA) [2].
Comparaison CO2 avion-voiture : que disent les chiffres ?
La question “avion vs voiture” quant à l’empreinte carbone requiert une analyse approfondie des données chiffrées. Les comparaisons directes révèlent des tendances surprenantes qui dépassent les perceptions habituelles.
Comparaison à distance équivalente (400-1000 km)
Pour les trajets de 400 à 1000 km, les émissions diffèrent significativement selon le mode de transport. D’après une étude de Carbone4, l’avion court-courrier émet environ 264 gCO2e par passager-kilomètre (construction incluse) [1]. Par ailleurs, la voiture thermique en autosolisme génère 240 gCO2e par passager-kilomètre [1], tandis que la voiture électrique en autosolisme n’émet que 112 gCO2e par passager-kilomètre [1].
Pour un trajet spécifique comme Paris-Rennes (environ 355 km), la pollution avion-voiture se chiffre à 92 kg de CO2e pour l’avion contre 77,2 kg pour une voiture thermique [13]. La différence s’accentue sur des distances plus longues : un Genève-Paris en avion émet 269 kg de CO2 par personne, contre seulement 75 kg en voiture avec quatre passagers [4].
Autosolisme ou taux de remplissage des avions
Le taux d’occupation joue un rôle déterminant dans cette comparaison. En effet, une voiture occupée par une seule personne (autosolisme) présente un bilan défavorable : sur le trajet Genève-Paris, elle génère 300 kg de CO2, dépassant ainsi l’avion (269 kg) [4]. Cependant, cette tendance s’inverse rapidement dès qu’on ajoute des passagers, les émissions étant divisées par deux avec deux occupants et par quatre avec quatre occupants [4].
Dans l’aérien, le remplissage influence également les émissions de CO2. Les émissions par passager augmentent considérablement lorsque l’avion est peu rempli [2]. De plus, la classe de voyage impacte fortement le bilan : voyager en classe affaires multiplie par trois l’empreinte carbone par rapport à la classe économique, et jusqu’à six fois en première classe [2]. Les compagnies low-cost, avec leurs cabines denses et bien remplies, affichent paradoxalement les émissions par passager les plus faibles [2].
Impact des infrastructures
Un aspect souvent négligé dans le bilan carbone avion + voiture concerne les infrastructures. Un avion a une durée d’exploitation d’environ 20 à 25 ans, tandis qu’une ligne ferroviaire représente un investissement sur 50 à 100 ans [14]. L’amortissement carbone des infrastructures ferroviaires reste conditionné à des taux d’occupation élevés : une ligne sous-utilisée ne réalise pas son potentiel de réduction d’émissions [14].
En matière d’évolution technologique, l’aviation progresse plus rapidement : chaque nouvelle génération d’avion réduit de 15 à 20% sa consommation de carburant [14]. En revanche, le ferroviaire, déjà mature sur le plan énergétique, offre moins de perspectives d’amélioration [14].
Alternatives bas carbone pour vos trajets
Après avoir examiné les empreintes carbone de l’avion et de la voiture, il convient d’explorer les alternatives plus respectueuses de l’environnement pour vos déplacements. Ces options permettent de réduire considérablement votre pollution avion-voiture.
Train : 3 à 10 gCO2/passager.km
Le train se positionne comme le champion incontesté de la mobilité bas carbone parmi les transports motorisés. En France, l’empreinte carbone varie selon le type de train : le TGV n’émet que 1,73 à 2,36 gCO2/voyageur.kilomètre [7] [15], tandis que l’Intercités se situe entre 5,29 et 5,92 gCO2/voy.km [7] [15]. Les TER, fonctionnant parfois au diesel, génèrent davantage d’émissions avec 24,81 à 29,6 gCO2/voy.km [7] [15].
Cette performance écologique s’explique par l’électrification importante du réseau ferroviaire français (58%) et un mix électrique relativement décarboné grâce au nucléaire et à l’hydroélectricité [6]. Par conséquent, le train s’avère 32 fois moins polluant que la voiture et 23 fois moins que l’avion [6], constituant ainsi une alternative idéale pour réduire votre empreinte carbone venant de l’aviation ou du transport routier.
Bus longue distance : 30 gCO2/passager au km
Pour les trajets où le train n’est pas disponible, le bus longue distance représente une alternative pertinente. Selon l’ADEME, un autocar thermique émet environ 30 gCO2/passager.km [16] [6]. Cette performance s’explique par le nombre élevé de passagers transportés simultanément – un seul bus remplace environ 30 voitures sur la route [6].
L’empreinte varie toutefois selon la motorisation : un bus électrique n’émet que 0,2 kg de CO₂e pour 10 km, contre 1,1 kg pour un bus thermique et 1,2 kg pour un bus au gaz naturel [16]. À titre de comparaison, pour un même trajet de 10 km, une voiture thermique émet 2,2 kg de CO₂ [16].
Covoiturage : optimiser l’usage de la voiture
Le covoiturage constitue une solution efficace pour diviser les émissions dues aux avions et voitures. En effet, cette pratique permet de réduire de moitié l’empreinte carbone des déplacements domicile-travail [5] et représente une économie annuelle de près de 2000€ pour un salarié habitant à 30 km de son lieu de travail [17] [5].
Concrètement, un trajet en covoiturage évite en moyenne l’émission de 6 kg de CO2 [5]. En milieu urbain dense, les économies peuvent atteindre 1,4 tonne de CO2 par an, soit une réduction de 12,5 % de l’empreinte carbone annuelle d’un Français [17]. En zone extra-urbaine, cette économie s’élève à 1,08 tonne, soit 9% de l’empreinte individuelle [17].
Par ailleurs, sur un trajet Paris-Marseille (750 km), la comparaison avion-voiture est éloquente : le TGV n’émet que 2,2 kgCO₂e, l’autocar 22,1 kgCO₂e, et le covoiturage thermique 81,6 kgCO₂e, bien moins que les 163 kgCO₂e d’une voiture thermique solo ou les 194 kgCO₂e d’un avion court-courrier [18].
Facteurs à considérer pour choisir son mode de transport
Choisir entre l’avion, la voiture ou d’autres modes de transport implique de considérer plusieurs facteurs au-delà de la seule empreinte carbone . Ces éléments déterminent non seulement l’impact environnemental, mais aussi l’expérience globale du voyageur.
Coût économique vs coût environnemental
La dimension économique pèse souvent lourd dans les choix de mobilité. En France, le coût annuel moyen d’une automobile s’élevait à 6 126€ en 2017 [19], tandis qu’un abonnement annuel aux transports en commun (Pass Navigo) ne coûte que 827,20 € [19]. Cette différence significative montre que se déplacer en voiture peut coûter jusqu’à 7 fois plus cher que d’utiliser les transports collectifs, notamment en Île-de-France [20].
Paradoxalement, les automobilistes ont tendance à sous-estimer le coût réel de leur véhicule [19], ne prenant généralement en compte que le carburant et ignorant les frais fixes (achat, assurance, entretien). Cette perception biaisée influence considérablement les choix de mobilité malgré la comparaison défavorable.
Temps de trajet et accessibilité
Le temps constitue un facteur déterminant dans nos décisions de transport. Un Français consacre en moyenne 10 heures hebdomadaires à ses déplacements, parcourant environ 400 kilomètres [20]. Les actifs passent en moyenne 40 minutes pour rejoindre leur lieu de travail [20], ce chiffre atteignant 50 minutes pour les Parisiens [20].
L’accessibilité joue également un rôle crucial : l’usage de la voiture double lorsque la distance à la gare la plus proche passe de moins d’un kilomètre (31 % des déplacements) à plus de cinq kilomètres (60 %) [21]. Cette proximité des infrastructures influence directement la pollution avion-voiture générée par nos choix quotidiens.
Confort, flexibilité et contraintes géographiques
Malgré les préoccupations environnementales croissantes, 80% des kilomètres parcourus par les Français le sont encore en voiture individuelle [22]. Ce choix s’explique par la flexibilité offerte, même si près de la moitié des déplacements urbains en automobile sont inférieurs à trois kilomètres [23].
Les contraintes géographiques orientent également les décisions : le train dessert directement les centres-villes [23], tandis que l’avion et parfois la voiture nécessitent des trajets complémentaires. En zone urbaine dense, les transports en commun offrent une alternative compétitive en termes de rapidité tout en réduisant la pollution, évitant au passage le stress des embouteillages et la recherche de stationnement [23].
Table de comparaison
| Critères | Avion | Voiture Thermique | Voiture Électrique | Train (TGV) | Bus Longue Distance |
| Émissions (gCO2/km/passager) | 259 | 218 | 103 | 1,73 – 2,36 | 30 |
| Part dans les émissions du transport | 3-5% | 52-53% | N/A | N/A | N/A |
| Phase de fabrication (% des émissions totales) | 0,15% | 12% | 81% | N/A | N/A |
| Phase d’usage (% des émissions totales) | 99,8% | 88% | 19% | N/A | N/A |
| Exemple Paris-Rennes (355 km) en kg CO2 | 92 | 77,2 | N/A | N/A | N/A |
| Impact du taux de remplissage | Multiplié par 3 en classe affaires, par 6 en première classe | Divisé par 2 avec 2 passagers, par 4 avec 4 passagers | N/A | N/A | N/A |
Note : N/A = Information non mentionnée dans l’article
Conclusion
Face aux données présentées dans cette analyse comparative, plusieurs constats s’imposent. L’empreinte carbone des différents modes de transport varie considérablement, avec le train qui se distingue nettement comme le champion de la mobilité durable (1,73 à 2,36 gCO2/km/passager). Les bus longue distance offrent également une alternative intéressante avec seulement 30 gCO2/km/passager, bien loin des 259 gCO2/km pour l’avion et des 218 gCO2/km pour la voiture thermique.
La voiture électrique, quant à elle, présente un bilan carbone deux fois moins important que son équivalent thermique. Néanmoins, cette performance doit être nuancée par le poids considérable de sa phase de fabrication, représentant 81% de ses émissions totales. Le « point de bascule » environnemental se situe entre 30 000 et 70 000 kilomètres selon les modèles.
Par ailleurs, le taux d’occupation des véhicules transforme radicalement leur bilan. Une voiture avec quatre passagers divise par quatre son empreinte carbone, tandis qu’un avion en classe affaires triple l’impact par voyageur. Cette réalité souligne l’importance du covoiturage comme solution accessible pour réduire significativement nos émissions.
Les choix de mobilité dépassent toutefois la seule question environnementale. Temps de trajet, coût économique, accessibilité et confort influencent nos décisions quotidiennes. Ainsi, malgré les préoccupations écologiques, 80% des kilomètres parcourus par les Français le sont encore en voiture individuelle.
En définitive, la réduction de notre empreinte carbone liée aux transports exige une approche pragmatique et adaptée à chaque situation. Les trajets courts peuvent privilégier les mobilités douces ou les transports en commun. Pour les moyennes distances, le train ou le bus s’avèrent souvent les options les plus écologiques. La voiture, particulièrement en version électrique et partagée, conserve sa pertinence dans certaines configurations. L’avion, bien que pratique pour les très longues distances, devrait être considéré comme une exception plutôt qu’une habitude.
La transition vers une mobilité plus durable ne signifie pas renoncer à nos déplacements, mais plutôt les repenser de manière plus consciente et responsable. Chaque kilomètre compte dans notre lutte collective contre le changement climatique.
FAQs
Q1. Quel mode de transport est le plus écologique pour les longues distances ? Le train est généralement le mode de transport le plus écologique pour les longues distances, émettant seulement 1,73 à 2,36 g de CO2 par passager-kilomètre pour un TGV en France. C’est nettement moins que la voiture ou l’avion.
Q2. Comment le covoiturage peut-il réduire l’empreinte carbone des déplacements ? Le covoiturage permet de diviser les émissions de CO2 par le nombre de passagers. Par exemple, une voiture avec quatre passagers divise par quatre son empreinte carbone par rapport à un conducteur seul, rendant ce mode de transport beaucoup plus écologique.
Q3. Quelle est la différence d’impact environnemental entre une voiture thermique et une voiture électrique ? Une voiture électrique émet en moyenne 103 gCO2/km contre 218 gCO2/km pour une voiture thermique. Cependant, la fabrication d’une voiture électrique génère plus d’émissions. Le « point de bascule » où l’électrique devient plus écologique se situe entre 30 000 et 70 000 km parcourus.
Q4. L’avion est-il toujours plus polluant que la voiture pour un même trajet ? Pas nécessairement. L’impact dépend de plusieurs facteurs comme la distance parcourue et le nombre de passagers. Par exemple, sur un trajet Paris-Rennes (355 km), l’avion émet 92 kg de CO2 contre 77,2 kg pour une voiture thermique. Le taux de remplissage joue un rôle crucial dans cette comparaison.
Q5. Quels sont les facteurs à considérer au-delà des émissions de CO2 pour choisir son mode de transport ? Au-delà de l’empreinte carbone, il faut prendre en compte le coût économique, le temps de trajet, l’accessibilité, le confort et les contraintes géographiques. Par exemple, le train dessert directement les centres-villes, tandis que l’avion nécessite souvent des trajets complémentaires.
Nos consultants spécialisés accompagnent les studios de production pour cadrer la stratégie, former les équipes et suivre les résultats. Nous adaptons l’approche aux contraintes du terrain.